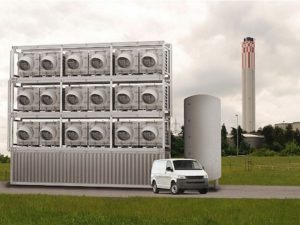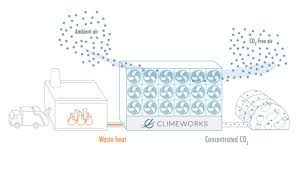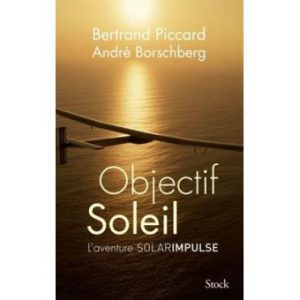Dimanche dernier s’achevait la célèbre Foire Internationale de l’Art Contemporain, plus communément connue sous l’acronyme FIAC. Avec 73 910 entrées en seulement cinq jours, soit une hausse de 2.5% par rapport à celle de l’année 2016, la foire parisienne a profité pleinement de sa notoriété pour faire vivre la capitale française à l’heure de l’art contemporain.
Pour cette 44ème édition haute en couleur, on ne compte pas moins de 190 galeries représentant les artistes les plus côtés et les plus émergents. Outre les galeries les plus importantes de la scène artistique internationale, toujours fidèles à ce rendez-vous annuel du marché de l’art, de nouveaux arrivés ont fait leur première apparition à la FIAC. Le Kosovo, la Tunisie et l’Egypte ont en effet fait leur entrée dans cette grande manifestation d’art contemporain de renommée mondiale, portant cette année à 29 le nombre de pays représentés à la FIAC.

Loin de sa première édition ayant eu lieu en 1974 dans la gare désaffectée de la Bastille, la FIAC de Paris a su devenir une des grandes dates du calendrier du marché de l’art. Investissant comme chaque mois d’octobre les différents espaces du Grand Palais et ayant développé encore cette année son programme « Hors les murs » avec des projets extérieurs dans le Jardin des Tuileries, le Petit Palais, la Place Vendôme ou encore le Musée National Eugène-Delacroix, cette édition de la FIAC a su faire exploser les enchères avec la vente notamment d’un Giacometti à 22 millions d’euros.